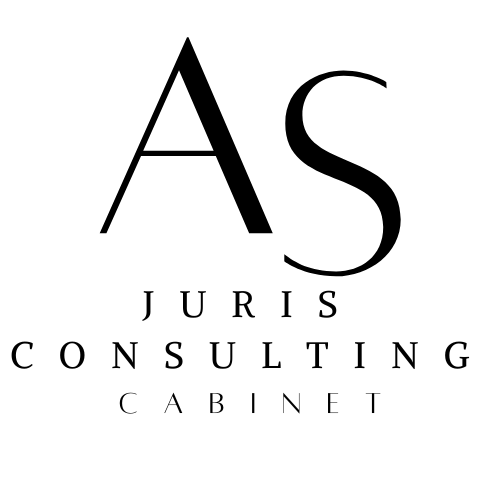Dans un avis rendu le 8 octobre, la Cour de cassation indique qu’une clause de déchéance du terme figurant dans un contrat de crédit à la consommation conclu à compter du 1er mai 2011 n’est pas susceptible d’être qualifiée d’illicite, mais peut en revanche être qualifiée d’abusive.

Dans les contrats de prêt d’argent, la clause de déchéance du terme fait figure de clause de style. Cette stipulation permet au créancier de revenir sur l’échéance à laquelle il a consenti. La totalité des sommes dues, intérêts échus et à échoir deviennent ainsi exigibles en cas de défaillance du débiteur ou en cas de non-respect des circonstances énumérées dans ladite clause (W. Dross, Clausier, 4e éd., LexisNexis 2020, p. 928. ; F. Buy, J. Heinich, M. Lamoureux, J. Mestre et J.-C. Roda [dir.], Les principales clauses des contrats d’affaires, 3e éd., LGDJ, 2025, n° 380, p. 191-192).
Eu égard à son objet et aux effets préjudiciables qu’il peut emporter pour l’une des parties, ce dispositif conventionnel, dès lors qu’il s’inscrit dans une opération souscrite par un consommateur, engendre un contentieux important (v. sur ce point, A. Gouëzel, Florilège de décisions sur les clauses de déchéance du terme, Gaz. Pal. 13 juin 2023. 37 ; v. dernièrement, Civ. 2e, 3 oct. 2024, n° 21-25.823 F-B, Dalloz actualité, 10 oct. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2025. 662, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ![]() ; Civ. 2e, avis, 11 juill. 2024, n° 24-70.004 P+B, Dalloz actualité, 10 sept. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 1374
; Civ. 2e, avis, 11 juill. 2024, n° 24-70.004 P+B, Dalloz actualité, 10 sept. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 1374 ![]() ; ibid. 2025. 1178, obs. A. Leborgne et J.-D. Pellier
; ibid. 2025. 1178, obs. A. Leborgne et J.-D. Pellier ![]() ; RCJPP 2024, n° 05, p. 14, obs. N. Fricero
; RCJPP 2024, n° 05, p. 14, obs. N. Fricero ![]() ; ibid., n° 05, p. 49, chron. F. Kieffer
; ibid., n° 05, p. 49, chron. F. Kieffer ![]() ; Civ. 1re, 29 mai 2024, n° 23-12.904 F-B, Dalloz actualité, 4 juin 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 1012
; Civ. 1re, 29 mai 2024, n° 23-12.904 F-B, Dalloz actualité, 4 juin 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 1012 ![]() ; RDI 2024. 622, obs. J. Bruttin
; RDI 2024. 622, obs. J. Bruttin ![]() ). L’avis rendu par la Cour de cassation le 8 octobre en est une nouvelle illustration.
). L’avis rendu par la Cour de cassation le 8 octobre en est une nouvelle illustration.
Les magistrats du quai de l’Horloge avaient été sollicités en avril 2025 par le Tribunal civil de première instance de Papeete, dans le cadre d’un litige opposant la société Banque de Polynésie à un consommateur. La Cour était invitée à répondre à la question suivante :
« La clause contenue dans un contrat de crédit à la consommation prévoyant la déchéance du terme pour un motif autre que celui relatif à la défaillance de l’emprunteur dans ses remboursements est-elle, pour les contrats conclus à partir du 1er mai 2011, abusive et /ou illicite ? »
De la réponse à cette question dépend la sanction qu’il convient de retenir : une clause déclarée illicite permet éventuellement de déchoir la banque de son droit aux intérêts, tandis qu’une clause qualifiée d’abusive est simplement mise à l’écart, par le biais de la sanction du réputé non écrit (N. Rzepecki, Les clauses abusives et illicites, LPA 28 juill. 2017. 8).
La première chambre civile se prononce en trois temps. En premier lieu, elle nous indique qu’une clause de déchéance du terme ne saurait être qualifiée d’illicite. Cette exclusion étant faite, la Cour précise ensuite qu’une clause de déchéance du terme peut, sous certaines conditions, être jugée abusive. Par conséquent et pour conclure, la Cour énonce qu’une clause de déchéance du terme peut être réputée non écrite, mais n’est point susceptible d’emporter la déchéance du droit aux intérêts pour l’établissement de crédit.
Ces trois éléments de réponse appellent respectivement quelques observations.
L’exclusion des clauses de déchéance du terme du champ des clauses illicites
Pour justifier l’exclusion des clauses de déchéance du terme du champ des clauses illicites, la Cour de cassation prend le soin d’opérer dans son avis quelques rappels historiques, en énonçant au préalable ce qu’il convient d’entendre par clause illicite.
Une clause illicite se définit tout simplement comme une clause formellement prohibée par la loi. Jusqu’en 2010, les offres de crédit à la consommation se présentaient comme des offres standardisées. Cette normalisation procédait de l’article 5 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 dite « loi Scrivener », inséré dans le code de la consommation à l’article L. 311-13. L’objectif affiché à l’époque était « d’assurer un véritable équilibre contractuel des engagements réciproques entre professionnels et consommateurs, et de permettre une information uniforme et étendue de ces derniers » (G. Poissonnier, L’offre préalable de crédit renouvelable n’est pas valable pour les crédits de type prêt personnel, D. 2011. 1396 ![]() ).
).
Dans cette configuration, l’offre de crédit pouvait contrevenir à l’article L. 311-13 de bien des façons. Pour la doctrine, il convenait de distinguer au sein de l’offre « les clauses légales, imposées par les modèles-types, et les clauses contractuelles qui, soit entraient dans le champ d’application des dispositions impératives, c’est-à-dire complétaient ou modifiaient les mentions imposées, soit n’en relevaient pas. Seules l’absence des premières et l’irrégularité des secondes, en ce qu’elles alourdissaient les obligations imposées [au consommateur], pouvaient entraîner, en application de l’ancien article L. 311-33 [la qualification de clause illicite et par voie de conséquence] la déchéance du droit aux intérêts » (N. Rzepecki, art. préc., p. 8-9).
Des clauses de déchéance du terme pouvaient donc, sous l’empire de la loi de 1978, être qualifiées d’illicites et/ou d’abusives lorsque le fondement de la disposition n’était pas la défaillance de l’emprunteur (J. Lasserre Capdeville, Le droit du crédit à la consommation 10 ans après la loi Lagarde, LDGJ, coll. « Les intégrales », 2021, nos 190 s. et 308).
Dans l’optique…
Source : Dalloz Actualités